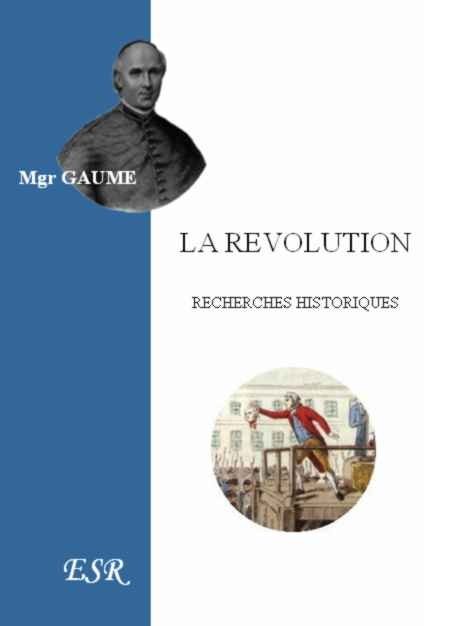Quelque optimiste qu’on soit, il est difficile de nier que le mal existe au sein des sociétés modernes, et même qu’il existe dans des proportions effrayantes.
— « Le mal n’est pas plus grand aujourd’hui qu’autrefois ; tous les siècles se ressemblent ; les hommes ont toujours été les mêmes ; notre époque peut soutenir la comparaison avec toutes les autres époques. » Voilà ce que plusieurs s’empressent de répondre.
« On entend dire assez communément, reprend le comte de Maistre, que tous les siècles se ressemblent et que les hommes ont toujours été les mêmes. Mais il faut bien se garder de ces maximes générales, que la légèreté ou la paresse inventent pour se dispenser de réfléchir. Tous les siècles, au contraire, manifestent un caractère particulier et distinctif qu’il faut considérer soigneusement. Sans doute, il y a toujours eu des vices dans le monde ; mais ces vices peuvent différer en quantité, en nature, en qualité dominante et en intensité. Ce qu’il y a d’extrêmement remarquable, c’est qu’à mesure que les siècles s’écoulent, les attaques contre l’édifice catholique deviennent toujours plus fortes ; en sorte qu’en disant toujours : II n’y a rien au delà, on se trompe toujours.
Mais ne nous en rapportons pas au témoignage d’autrui. Comparons nous-mêmes l’Europe d’aujourd’hui à l’Europe d’autrefois. Afin d’avoir les termes d’une comparaison sérieuse, remontons à l’époque qui divise en deux parties l’histoire des sociétés chrétiennes, à cette époque dont le nom seul indique la fin du moyen âge et le commencement de l’ère moderne, la Renaissance.
Si, d’une part, il est vrai que le catholicisme, qui seul rend raison du pouvoir et du devoir, est l’âme des sociétés ; si, d’autre part, il est vrai, comme on le prétend, que notre époque peut soutenir la comparaison avec toutes les autres époques, cette proposition signifie, qu’aujourd’hui le catholicisme est appliqué à la société, à la famille, où l’individu, d’une manière au moins aussi intime et aussi complète qu’autrefois»
Voyons ce qu’il faut penser de cette affirmation.
Premier fait — À part quelques contrées septentrionales, l’Europe, il y a quatre siècles, était toute catholique. Aujourd’hui, la moitié de l’Europe n’est plus catholique, l’autre moitié ne l’est guère qu’à demi.
Deuxième fait. — Il y a quatre siècles, l’indissolubilité du lien conjugal était la loi universelle de la famille. Aujourd’hui le divorce est légalement établi dans la moitié de l’Europe.
Troisième fait. — Il y a quatre siècles, le suicide, cet attentat suprême qui annonce, chez ceux qui s’en rendent coupables, l’extinction du sens moral, était inconnu des nations chrétiennes. Aujourd’hui, ce crime, qui aurait épouvanté nos pères, est devenu si commun qu’on n’y fait plus attention, et que même il a ses apologistes. Sous ce triple rapport le catholicisme est-il appliqué à la société, à la famille, à l’individu, d’une manière aussi complète qu’autrefois ?
Quatrième fait. — Il y a quatre siècles, il n’y avait pas de théâtres en Europe ; pas d’arts corrupteurs, pas de conspiration générale du talent et du génie contre la foi et les mœurs. Aujourd’hui, l’Europe est couverte de théâtres, où chaque soir des milliers de spectateurs applaudissent à la mise en scène et au triomphe des plus dangereuses passions. Les rues, les places, les jardins publics sont peuplés de statues indécentes ; les galeries, les salons, les livres offrent de toutes parts des tableaux et des gravures que la pudeur ne peut regarder sans rougir. Des milliers d’intelligences inondent, depuis quatre siècles, l’Europe entière d’ouvrages en vers et en prose, dans lesquels il n’est pas un crime contre Dieu, contre l’Église, contre les pouvoirs publics, contre les époux et les parents, qui ne trouve sa formule et même son apologie.
A tous ces points de vue, notre époque peut-elle soutenir la comparaison avec les époques où rien de tout cela n’existait ?
Cinquième fait. — Tandis qu’autrefois l’Europe avait une hiérarchie sociale, des libertés publiques, une conscience publique ; tandis que chez les nations chrétiennes la paix n’était troublée qu’à la surface, c’est-à-dire dans l’ordre des faits et non dans l’ordre des principes, en sorte que les dynasties avaient un lendemain et les peuples un avenir : aujourd’hui toute hiérarchie sociale composée d’éléments naturels et historiques a disparu ; toutes les libertés publiques sont absorbées par la centralisation ; la conscience publique altérée ou éteinte ne flétrit plus guère que l’insuccès ; les bases même de la famille et de la propriété sont ébranlées jusque dans leurs profondeurs ; nous marchons de révolutions en révolutions, de chutes en chutes ; des sociétés secrètes enlacent l’ancien et le nouveau monde dans un immense réseau ; font assassiner le Président de la République de l’Équateur, et la Commune, avec toutes ses horreurs, n’est pour elles qu’un combat d’avant-garde. Enfin, la morale privée allant de pair avec la décadence sociale, nous sommes tombés dans l’enfouissement humain ; ce qui nous met cent pieds au-dessous des sauvages.
Dans les âmes ou dans les rues, la Révolution est en permanence. Sur leurs trônes chancelants, les rois ressemblent aux matelots placés au sommet du navire pendant la tempête. Le bruit du trône qui s’écroule aujourd’hui, annonce presque toujours la chute du trône qui s’écroulera demain. Les peuples mécontents nourrissent au fond de leur cœur la haine de toute supériorité, la convoitise de toute jouissance, l’impatience de tout frein, et la force matérielle est devenue l’unique garantie de l’ordre social. Et malgré cette force imposante, malgré le progrès, malgré l’industrie, malgré ce qu’on appelle la civilisation, I’EUROPE A PEUR. Un secret instinct lui dit qu’elle peut périr, comme Balthasar, au milieu d’un banquet, la coupe de la volupté à la main.
Qu’on veuille bien méditer froidement et sans parti pris ces points de comparaison, qu’il serait facile de multiplier, et dire si l’époque où l’on trouve tous ces symptômes, peut soutenir le parallèle avec toutes les autres époques de l’histoire.
L’affirmer, c’est prétendre : ou qu’aucune des choses qui viennent d’être signalées n’est un mal ni une cause de mal ; ou que l’Europe moderne offre, sous d’autres rapports, une compensation tellement abondante, qu’il lui reste un patrimoine de vérités et de vertus, en un mot de catholicisme, au moins égal à celui de ses aïeux/ En est-il ainsi ?
A part quelques symptômes heureux dont il ne faut ni contester l’existence ni exagérer la signification, partout le mal reste stationnaire ou continue ses funestes progrès.
Pas une des nations séparées de l’Église par le schisme ou par l’hérésie n’a fait, comme nation, un pas pour rentrer au bercail.
Au sein même des pays demeurés catholiques, à qui appartient la moisson des âmes ? En France, en Italie, en Belgique, en Espagne, quels journaux tiennent le dé de la conversation ?
On parle d’un mouvement religieux : mais quel est-il ? individuel ou social ? Les conversions sauvent les particuliers, le retour aux principes peut seul sauver les nations. Or, quelle place ont reprise, dans les constitutions et les chartes modernes, les principes sociaux du christianisme ? L’amour, l’indifférence, la crainte ou la haine, lequel de ces sentiments domine notre époque, à l’égard de l’Église, cette grande monarchie des intelligences, établie dans le monde moral pour y maintenir l’harmonie, comme le soleil la maintient dans le monde planétaire? Qu’est devenue son indépendance territoriale, la soumission à ses préceptes, l’entière liberté de son action ?
On parle des crimes d’autrefois : où sont les iniquités privées et publiques commises par nos pères et que nous ne commettons plus, que nous commettons moins souvent, avec des caractères moins odieux, ou que nous expions par des remords plus sincères et par des réparations plus éclatantes? Que disent chaque année les statistiques de la justice criminelle ?
Le naturalisme en religion, la centralisation en politique, l’affaiblissement du sens moral, le mépris de l’autorité, quelque soit son nom, l’empire ténébreux des sociétés secrètes, le règne visible du sensualisme, ces grands symptômes de décadence inconnus autrefois, sont des faits qui frappent tous les regards, et pour lesquels il n’y a pas de condensation.
Pour tout dire d’un seul mot : l’émancipation progressive de l’Europe de la tutelle du catholicisme, sa sortie de l’ordre divin et la substitution, en toutes choses, de la souveraineté de l’homme à la souveraineté de Dieu : voilà le caractère distinctif de l’époque moderne ; voilà ce que nous appelons la Révolution ; voilà le mal !
Du reste, qu’on veuille bien le remarquer, la comparaison qui précède n’a pour but ni de dénigrer l’époque actuelle ni de jeter le découragement dans les âmes. Il reste encore de bons éléments, surtout en France ; la sève de la foi qui opère par la charité circule encore active et abondante dans les veines d’un grand nombre de chrétiens, toujours restés fidèles à la vérité, ou heureusement revenus de leurs erreurs ; enfin, la main maternelle de la Providence demeure visiblement étendue sur l’Europe occidentale.
Mettre l’opinion en garde contre les endormeurs, réveiller le zèle de tous en signalant la grandeur du mal et l’imminence du péril, tel est le but de cette esquisse.
Et maintenant, ce mal qui nous enveloppe et nous pénètre de toutes parts ; ce mal que chacun voit de ses yeux et touche de ses mains, qui aux uns fait pousser des cris de joie, aux autres des cris d’alarme ; ce mal qui lient l’ordre social en échec et le monde suspendu sur un abîme : d’où vient-il ?
Après le péché originel les uns le voient principalement : dans la Révolution française et la liberté de la presse qui en est sortie ; les autres, dans le Voltairianisme ou la philosophie du dix-huitième siècle ; ceux-là, dans le Césarisme ou la politique païenne; ceux-ci, dans le Protestantisme ; quelques-uns, dans le Rationalisme ; plusieurs, dans la Renaissance.
Ainsi, les causes prochaines et généralement reconnues du mal seraient :
- La Révolution française,
- Le Voltairianisme,
- Le Césarisme,
- Le Protestantisme,
- Le Rationalisme,
- La Renaissance.
On ne peut nier qu’il y ait de tout cela dans la maladie sociale. Mais toutes ces causes sont-elles réellement des causes et des causes isolées, indépendantes les unes des autres, et non les effets successifs d’une cause première, les évolutions différentes d’un même principe ? Pour le savoir, et il importe souverainement de ne pas l’ignorer. il faut, l’histoire à la main, faire la généalogie de chacune. Si le résultat invariable de cette étude est de montrer, dans tous ces faits, le même principe générateur, dans toutes ces causes une racine commune de laquelle toutes sont sorties, il faudra bien reconnaître, pour cause principale et prochaine du mal actuel, ce principe dont tout ce que nous voyons est la conséquence.
Il importe souverainement, disons-nous, de ne pas l’ignorer. Ce n’est pas en un jour que la société est arrivée dans le défilé redoutable où elle peut périr. Nous sommes fils de nos pères ; nous portons le poids de leur héritage. Avant tout, il est nécessaire de bien connaître le passé, qui seul explique le présent. Il est nécessaire que nous sachions sur quelle pente V monde s’est abandonné, et vers quels sommets il doit reprendre son essor. C’est dire que l’histoire généalogique du mal actuel est d’une importance capitale.
L’ignorer, c’est nous exposer à égarer nos coups, à nous consumer à frapper les branches en épargnant la racine, c’est diviser nos forces. Or, en présence de la redoutable unité du mal, diviser nos forces est plus qu’un péril, c’est une faute ; lutter isolément, c’est se faire battre ; rester sur la défensive, c’est tout au plus retarder l’heure de périr.
Si on n’y prend garde, les éléments de régénération qui nous restent n’iront-ils pas en s’affaiblissant ? Ce mot fatal : Il est trop tard, que quelques-uns murmurent déjà, ne deviendra-t-il pas le cri général ? Le présent n’offre qu’un point d’appui chancelant, Derrière un épais rideau cache l’avenir : l’avenir, plein d’espérance pour les uns, de terreur pour les autres, de mystère pour tous ; par les uns salué comme le règne absolu du bien, par les autres redouté comme le règne absolu du mal, par tous attendu avec anxiété. Or, l’avenir sera ce que nous l’aurons fait.
Dans cette situation quel parti prendre ? Se lamenter? Ce serait puérilité. S’endormir en comptant sur l’imprévu ? Ce serait fatalisme. Que faut-il donc faire ? Il faut combattre.
Combattre, c’est, d’abord, se vaincre soi-même en se dépouillant de tout préjugé, afin de rechercher avec succès la véritable cause du mal . C’est, ensuite, l’attaquer avec ensemble et avec vigueur. Quelles que soient les destinées du monde, ce courageux labeur ne sera pas sans fruit : il contribuera puissamment à former ou de nobles vainqueurs, ou de nobles victimes.
Qu’on veuille bien ne pas l’oublier : la question du mal n’est pas une question spéculative ou purement religieuse ou indifférente pour le grand nombre. Il n’en est pas de plus pratique , ni de plus grave ni qui touche de plus près à tous les genres d’intérêts. Elle est vraiment, et à tous les points de vue, la question de vie ou de mort. Les flots menaçants, qui naguère ont failli déborder sur la société, continuent de battre à la porte de chaque demeure. Qui peut répondre longtemps encore de la solidité des digues tant de fois menacées qui les arrêtent ? Et si, aujourd’hui, ces digues venaient à céder, qui peut dire que nous ne serions pas emportés, demain, dans un cataclysme tel que le monde n’en a point vu ?
Afin de concourir, autant qu’il est en nous, à l’œuvre de salut commun, nous allons, en commençant par la Révolution française, étudier successivement dans son origine, dans ses caractères et dans son influence, chacune des causes du mal indiquées plus haut.
Ici, ni polémique ni discussion, ni esprit de système ni parti pris, mais des faits : des faits authentiques, des faits rapportés avec impartialité, et dont nous laisserons même à autrui le soin d’apprécier la signification et de tirer les conséquences. Simple narrateur , nous donnerons constamment la parole à l’histoire. Son autorité et non la nôtre doit servir de base au jugement du lecteur.
La seule chose que nous demandons, c’est qu’on s’abstienne de prononcer avant d’avoir lu.
Mgr Gaume, Protonotaire Apostolique, Docteur en Théologie (1877)
Télécharger “"La Révolution" de Mgr Gaume” La-Revolution-Mgr-Gaume.pdf – Téléchargé 513 fois – 7,67 MoDisponible en version papier en cliquant sur la photo ci-dessous